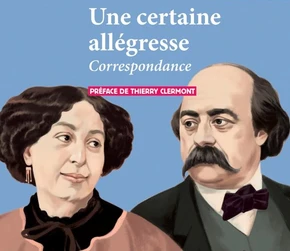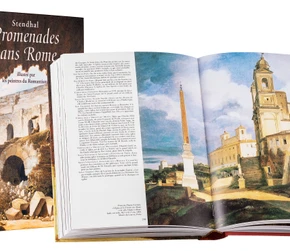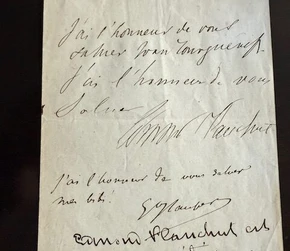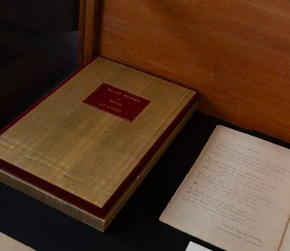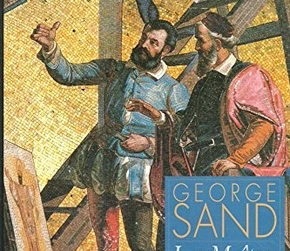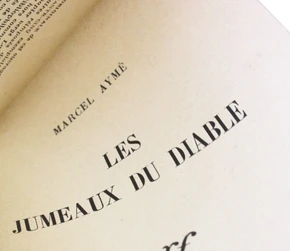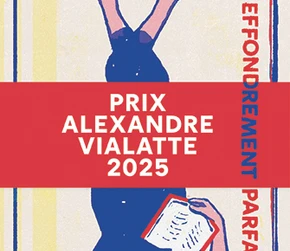Restez à la page !
Le Blog des Hôtels Littéraires est l’instrument privilégié de notre communication culturelle. Des articles sont régulièrement publiés, réunissant nos dernières émotions : notes de lectures, prix littéraires, entretiens, découvertes et nouvelles acquisitions pour les collections.
Une lettre mensuelle relaie les articles auprès des abonnés et publie l’agenda des événements à venir : pour ne rien manquer de l’actualité culturelle et contribuer au rayonnement de la culture et des livres!