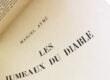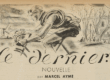Les Maîtres mosaïstes, un roman de George Sand – par Jacques Letertre
J’ai écrit les Mosaïstes en 1837, pour mon fils, qui n’avait encore lu qu’un roman, Paul et Virginie. Cette lecture était trop forte pour les nerfs d’un pauvre enfant. Il avait tant pleuré, que je lui avais promis de lui faire un roman où il n’y aurait pas d’amour et où toutes choses finiraient pour le mieux. Pour joindre un peu d’instruction à son amusement, je pris un fait réel dans l’histoire de l’art. Les aventures des mosaïstes de Saint-Marc sont vraies en grande partie. Je n’y ai cousu que quelques ornements, et j’ai développé des caractères que le fait même indique d’une manière assez certaine.
Je ne sais pourquoi j’ai écrit peu de livres avec autant de plaisir que celui-là. C’était à la campagne, par un été aussi chaud que le climat de l’Italie que je venais de quitter. Jamais je n’ai vu autant de fleurs et d’oiseaux dans mon jardin. Liszt jouait du piano au rez-de-chaussée, et les rossignols, enivrés de musique et de soleil, s’égosillaient avec rage sur les lilas environnants.
George Sand, Nohant, mai 1852.
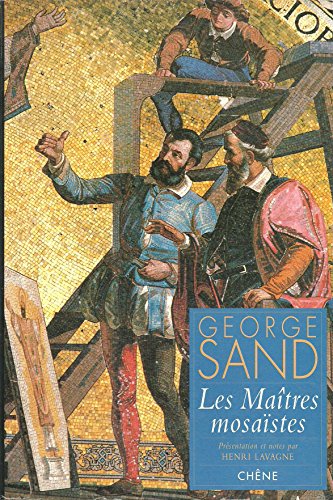
En août 1834, George Sand, qui après un hiver de passion et de déchirement avec Musset a prolongé de quatre mois son séjour à Venise, est de retour à Nohant où elle rassemble les notes qui mèneront à la rédaction de son roman vénitien.
Elle y reste imprégnée du charme de Venise et de sa peinture ; pour tout décor, elle reconstitue une de ces belles soirées de Venise qu’elle avait adorées dans sa « parenthèse enchantée » du printemps sans Musset :
C’était durant les belles nuits d’été, à la clarté pleine et suave de la lune des mers orientales, qu’assis sous une treille en fleur, abreuvés du doux parfum de la vigne et du jasmin, nous soupions gaiement de minuit à deux heures dans les jardins de Santa Margarita. Nos convives étaient Assem Zuzuf, honnête négociant de Corcyre ; le signor Lélio, premier chanteur du théâtre de la Fenice ; le docteur Acrocéronius, la charmante Beppa et le bel abbé Panorio. Un rossignol chantait dans sa cage verte, suspendue au treillage qui abritait la table. Au sorbet, Beppa accordait un luth et chantait d’une voix plus mélodieuse encore que celle du rossignol…
Lequel abbé Panorio raconte alors une histoire, inspirée de faits réels, qui se déroule dans le Venise de la Renaissance. C’est un Venise de fêtes sans fin, où l’on croise Titien et Veronese, le doge Mocenigo et le futur Henri III, le vin de Chypre et les Compagnons du Lézard (allusion à la compagnie de la Calza chère à Carpaccio), de surprenantes courses de chevaux, un épisode de peste, l’horreur de la prison des Plombs et le pouvoir de l’Inquisition.
C’est l’occasion pour les peintres Sebastiano Zuccato, et Jacopo Robusti (Tintoret) de débattre de la qualité artistique du travail des peintres et des mosaïstes et si Zuccati considère qu’il s’agit d’un un art mineur, regrettant amèrement que ses deux fils, Francesco et Valério, l’aient choisi plutôt que la peinture, Tintoret au contraire rappelle tout l’intérêt de cet art qui, remontant à l’Antiquité grecque, impose le respect et plaide en faveur du talent des deux garçons.
Les frères Zuccato et leurs adversaires, les fourbes Bianchini, composent les deux écoles de mosaïstes rivales qui se partagent la rénovation de la Basilique Saint Marc. Mais si les frères Zuccato sont aimés de tous, attentifs à leurs compagnons et talentueux, les Bianchini, cupides et jaloux, ont mauvaise réputation.
 L’extase de saint Marc – Basilique saint Marc, Venise
L’extase de saint Marc – Basilique saint Marc, Venise
Usant de mensonges et de vils procédés, les Bianchini montent un terrible complot afin de faire tomber leurs rivaux dans un piège diabolique. De fait, ils parviennent à faire condamner pour fraude les deux frères et à les faire jeter en prison, “sous les plombs”.
Mais après moultes péripéties qui voient se réunir un jury d’honneur composé rien moins que de Titien, Veronese, Tintoret, Schiavone et Sansovino, les mensonges sont découverts, les voiles sont levés sur les intrigues et comme George Sand s’y était engagée pour son fils, l’histoire se termine par la victoire de Francesco et Valerio Zuccato, lavés de toute accusation et loués pour leur honnêteté, leur grandeur d’âme et leur talent.

Si ce charmant conte est une pure fiction, il n’en demeure pas moins que George Sand retrace magnifiquement les relations conflictuelles qui existaient dans la Venise du XVIe siècle entre les ateliers des maîtres mosaïstes, chacun gardant le secret de ses technique de fabrication, la jalousie et les intrigues, les dénonciations et coups bas auprès des autorités de la République de Venise pour obtenir des grands contrats publics.
Ce climat de concurrence traduit aussi une époque où l’art de la mosaïque, d’abord ancré dans la tradition byzantine, cherche à se renouveler face à la montée de la peinture sur toile et à l’évolution du goût artistique vénitien, ce qui entraîne des tensions internes et externes.
Historiquement, ces conflits découlaient également des statuts stricts des corporations, de la division rigoureuse du travail artistique, les peintres préparant les cartons et guidant le travail des mosaïstes.
Dans le roman, cette rivalité prend la forme d’une compétition exacerbée, parfois tragique, mais aussi source d’innovation artistique et de transmission du savoir, chaque école cherchant à s’imposer comme la plus prestigieuse dans la Venise de la Renaissance.
Il est intéressant de noter que Sebastiano Zuccato, qui dans ce conte reproche amèrement à ses fils d’être mosaïstes et non peintres – “j’ai deux fils parjures à mon honneur” – a été maître en mosaïque à Venise au XVIe siècle. Il fut pendant quelques années, le premier maître de Titien, avant que celui ci ne rejoigne l’atelier de Gentile Bellini puis de son frère Giovanni Bellini.

Autoportrait du Titien, vers 1562. Musée du Prado, Madrid
Jacques Letertre