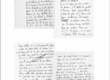Mademoiselle de Saint-Loup : clé de voûte de la Recherche. Fragments de la bibliothèque de l’Hôtel Littéraire Le Swann
Par Jacques Letertre.
Extrait de l’article paru dans le Bulletin Marcel Proust numéro 71, 2021.
Ces quelques notes reposent sur le bonheur qui consiste à aller d’un manuscrit à une édition originale de sa bibliothèque pour essayer de dérouler le fil d’une pelote. Ici, l’exercice consistait à en savoir plus sur une lettre inédite du 19 janvier 1955 envoyée par André Maurois à Pierre Clarac, l’un des deux éditeurs de la première édition dans la « Bibliothèque de la Pléiade » d’À la recherche du temps perdu. Il y disait que « c’était la première fois que nous lisons réellement la Recherche du temps perdu » tout en qualifiant sa propre préface à cette édition, qui fit autorité jusqu’à celle de 1987, de « bien indigne d’un si grand projet ». André Maurois était injuste avec lui-même car sa préface synthétique, lumineuse, nous confiait, entre autres choses, cette formule choc :
La clé de voûte de toute l’œuvre est sans doute Mademoiselle de Saint-Loup, fille de Robert et de Gilberte. Ce n’est qu’une petite figure sculptée, à peine visible d’en bas, mais en elle, le temps s’est, à la lettre, matérialisé. L’arche est liée, la cathédrale achevée…[1]
C’est aussi ce que soulignait Marcel Proust en écrivant : « Et quand vous me parlez de cathédrales, je ne peux pas ne pas être ému d’une intuition qui vous permet de deviner, ce que je n’ai jamais dit à personne et que j’écris pour la première fois, c’est que j’avais voulu donner à chaque partie de mon livre le titre : Porche I Vitraux de l’abside etc…[2] »
Pierre Clarac avait peut-être été moins conquis par À la recherche de Marcel Proust d’André Maurois, puisque son exemplaire – pourtant de tête, un des 20 sur hollande – n’a jamais été coupé et avait seulement été « truffé » de cette lettre du 19 janvier 1955 et d’une carte de visite de madame Gérard Mante. Mais il est plus probable qu’il l’avait lu dans un exemplaire ordinaire pour ne pas couper l’autre.
Photo originale tirage argentique 1922. Portrait de Simone de Caillavet-Stoicesco
Mlle de Saint-Loup dans la Recherche
Elle n’a pas de prénom et, bien que présente dans les esquisses de Du côté de chez Swann en 1907, n’intervient que onze fois dans le livre et seulement pour l’essentiel dans les vingt dernières pages du Temps retrouvé. Une présence muette puisqu’elle se contente de sourire et de laisser admirer son profil de statue. Nous savons juste qu’elle est de taille élevée, son visage aux « yeux forés et perçants » et un « nez charmant, légèrement avancé, en forme de bec et courbé »[3]. Fille unique de Gilberte Swann et de Robert de Saint-Loup, elle aurait dû s’appeler Montargis, comme son père, jusqu’aux émouvantes transformations du placard 31[4].
C’est en partie à cause d’elle que Gilberte quitte Paris pendant la guerre : « Les raids perpétuels de taubes au-dessus de Paris lui avaient causé une telle épouvante, surtout pour sa petite fille, qu’elle [Gilberte] s’était enfuie de Paris » (RTP, IV, 330).
Qualifiée de « jolie fille » (RTP, IV, 541) elle ne fait véritablement son apparition que lors de la matinée de la Princesse de Guermantes, où Gilberte dit au Narrateur combien Saint-Loup avait été « fier » de sa fille, à propos de laquelle le narrateur ajoute : « Cette, fille dont le nom et la fortune pouvaient faire espérer à sa mère qu’elle épouserait un prince royal et couronnerait toute l’œuvre ascendante de Swann et de sa femme, choisit plus tard comme mari un homme de lettres obscur » (RTP, IV, 605). Certains critiques ont même été jusqu’à y voir le mariage du Narrateur, ce que Jacques Dubois appelle « le grand déclassement[5] » : « En cette fin de roman, la gent littéraire s’y bouscule soudain, en font partie Bloch, Octave et le futur mari de mademoiselle de Saint-Loup », sans oublier bien sûr le Narrateur.
Proust multiplie les ambiguïtés quant à la vie privée de Mlle de Saint-Loup allant jusqu’à suggérer que Gilberte, par atavisme familial, était prête à jouer les entremetteuses et à fournir le Narrateur en « chair fraîche » : « Gilberte qui tenait sans doute là un peu de l’ascendance de sa mère (et c’est bien cette facilité que j’avais sans m’en rendre compte escomptée, en lui demandant de me faire connaître de très jeunes filles) […]. » (RTP, IV, 605). L’usage du « sans doute » et du « sans m’en rendre compte » ne change rien à la crudité du propos. Mais là encore Le Narrateur va plus loin en suggérant une proposition encore plus indécente :
…sans doute pour que le profit ne sortît pas de la famille […] elle me dit : « Si vous le permettez, je vais aller vous chercher ma fille pour vous la présenter. Elle est là-bas qui cause avec le petit Mortemart et d’autres bambins sans intérêt. Je suis sûre qu’elle sera une gentille amie pour vous. » (RTP, IV, 605).
Ce rôle central de Mlle de Saint-Loup est confirmé par le Narrateur qui, s’il ne parle pas comme Maurois de « clé de voûte », se pose cependant la question suivante :
[…] n’était-elle pas comme sont dans les forêts les « étoiles » des carrefours où viennent converger des routes venues, pour notre vie aussi, des points les plus différents ? Elles étaient nombreuses pour moi, celles qui aboutissaient à Mlle de Saint-Loup et qui rayonnaient autour d’elle. Et avant tout venaient aboutir à elle les deux grands « côtés » où j’avais fait tant de promenades et de rêves – par son père Robert de Saint-Loup le côté de Guermantes, par Gilberte sa mère le côté de Méséglise qui était le « côté de chez Swann ». L’une, par la mère de la jeune fille et les Champs-Élysées, me menait jusqu’à Swann, à mes soirs de Combray […] l’autre, par son père, à mes après-midi de Balbec où je le revoyais près de la mer ensoleillée. (RTP, IV, 606).
Le Narrateur ajoute qu’elle conduisait également « à la dame en rose, qui était sa grand-mère et que j’avais vue chez mon grand-oncle » dont le valet « était le père du jeune homme que non seulement M de Charlus, mais le père même de Mlle de Saint-Loup avait aimé » « Et, continue-t-il, n’était-ce pas le grand-père de Mlle de Saint-Loup, Swann, qui m’avait le premier parlé de la musique de Vinteuil, de même que Gilberte m’avait la première parlé d’Albertine ? » (RTP, IV, 607).
Nous assistons ici à un résumé de l’ensemble des tomes précédents, une synthèse en quelques pages des événements enchevêtrés et interdépendants de la vie du Narrateur. En effet, Mlle de Saint-Loup incarne le Temps : « Le temps incolore et insaisissable s’était, pour que pour ainsi dire je puisse le voir et le toucher, matérialisé en elle […] ». Et, remarque-t-il, « cette idée du Temps avait un dernier prix pour moi, elle était un aiguillon, elle me disait qu’il était temps de commencer » (RTP, IV, 608-609).
Mlle de Saint-Loup est un symbole vivant de multiples mariages, de rencontres et de brouilles. Le Narrateur fait sa rencontre chez la princesse de Guermantes (autrefois Madame Verdurin), là où en son temps il avait connu son grand-père, Charles Swann, et elle lui est présentée par sa mère, Gilberte ex-Swann, ex-Forcheville et veuve Saint-Loup.
Simone Arman de Caillavet, unique modèle de Mlle de Saint-Loup
À la différence de la quasi-totalité des personnages de la Recherche qui résultent d’un patchwork de personnes existantes, Mlle de Saint-Loup ne pouvait, de par sa filiation, son âge, son physique, être quelqu’un d’autre que Simone Arman de Caillavet. Madame André Maurois par mariage, née le 8 février 1894 et décédée le 22 décembre 1968, elle est entrée dans nos collections via une photo et un livre :
- La photo[6], qui date de 1922 (l’année même de la mort de Proust), est un tirage argentique. Simone y porte une robe de Lucien Lelong. On sait l’importance des photos pour Marcel Proust : il se fâchera avec Gaston Arman de Caillavet, suite à ses demandes incessantes de photos de la future Jeanne de Caillavet. Cette passion est confirmée dans une lettre de 1910 à Jeanne de Caillavet : « Quelle émotion… la photographie de vous qui est là, a-t-elle été faite au tennis autrefois entre la petite Daireaux et mesdemoiselles Dancongnée? » (Corr. X, 46). Cette photo, devenue très célèbre, montre Jeanne Pouquet et Marcel Proust au tennis Bineau, elle debout sur une chaise et lui à genoux, une raquette de tennis à la main en guise de mandoline. Proust ira jusqu’à offrir une photo de lui à Gaston avec cette dédicace : « Au seul Gaston, le sien / Marcel[7] ».
- Le livre, c’est Le Candidat de Flaubert (déjà un clin d’œil à Proust) qu’André Maurois avait offert à Simone, non sans l’avoir auparavant « truffé » de trois lettres originales de Flaubert[8].
Simone Arman de Caillavet baigne depuis toujours dans le monde des Lettres : fille unique du dramaturge à succès Gaston Arman de Caillavet et de Jeanne née Pouquet (auteur du Salon de Mme de Caillavet), elle est la petite fille de Léontine Arman, née Lippman, qui sera la muse et la maîtresse d’Anatole France. Écrivaine et poétesse, elle publie en 1918 un recueil de poèmes, Les Heures latines, avec, comme pour Marcel Proust et ses Plaisirs et les Jours, une préface d’Anatole France. Devenue Madame André Maurois, elle s’essaiera au livre historique avec, en 1956, Miss Howard : la femme qui fit un empereur[9].
À la différence du mariage de Gilberte et Robert, l’union Caillavet – Pouquet n’est pas la réconciliation miraculeuse de deux classes sociales différentes : Jeanne et Gaston sont tous deux issus de la grande bourgeoisie. Rien d’aristocratique, surtout pas chez les Caillavet. Et si réconciliation il y a, c’est entre catholiques très antirépublicains, antidreyfusards et conservateurs du côté Pouquet (Eugène Pouquet est un ancien zouave pontifical et agent de change) et une bourgeoisie libérale voire franc-maçonne du côté des Arman, plus tard « de » Caillavet. Proust servira d’ailleurs de leurre pour le père de Jeanne qui ne veut en aucun cas d’union avec une famille aussi scandaleuse.
Cependant, outre l’existence d’une fille unique comme chez les Saint-Loup, le couple Caillavet est lui aussi désuni. Proust, comme il le dira à Céleste, était convaincu que Gaston, volage, avait envisagé de quitter Jeanne pour une danseuse. Comme Saint-Loup, Gaston mourra pendant la guerre (d’une crise d’urémie comme la mère et la grand-mère de Proust). Autre point commun, les souvenirs militaires : ils ont effectué successivement leur volontariat l’un à Versailles, l’autre à Orléans. En revanche, Jeanne, qui a trois ans de moins que Marcel, ne saurait être considérée comme la Gilberte des Champs-Élysées, n’était l’épisode de la natte. Quant au couple mère-fille et leurs relations avec Proust, comme le note Jean-Yves Tadié : « Marcel confie à la domestique des Pouquet : Je ne sais plus qui j’aime le mieux de la mère et de la fille ! (Marie ou Jeanne), comme le Narrateur pris entre Odette et Gilberte. »[10]
À la mort de son père à 45 ans, Simone, alors âgée de 21 ans, fuit le domicile familial et se réfugie chez son tuteur, un autre grand ami de Proust, Robert de Flers. Elle s’engage ensuite comme infirmière : « Cela m’amuse d’être assimilée à un soldat… Et puis le voile est si seyant. On vous a des airs de béguines, on est adorée des mourants. »[11]
Marcel Proust prend le rôle de l’amoureux malgré lui, de la fiancée de son meilleur ami. Comme il le fera avec Morand, avec Albufera, il s’immisce dans le couple, exagère ses sentiments, multiplie les déclarations d’amour passionné, fait semblant de se sacrifier avec l’espoir d’y gagner l’affection des deux. Son rôle sera vite souvent celui d’un simple chandelier, comme l’écrira plusieurs fois Jeanne.
Après avoir été brièvement fiancée à Bertrand de Salignac Fénelon (autre modèle de Saint-Loup), fiançailles que nie Michelle Maurois, elle rencontre un diplomate roumain George Stoicesco. Proust désapprouve ce mariage de Simone. Il ira jusqu’à écrire : « Simone de Caillavet épouse le plus détestable des roumains. (Corr. XXI, 461).
Les 19 lettres manuscrites de Marcel Proust à Jeanne Arman de Caillavet.
Nous avons la chance de disposer de dix-neuf lettres manuscrites de Marcel Proust à Jeanne Arman de Caillavet. Certaines de ces lettres figurent dans l’édition Hachette de 1928, que l’on retrouve, toujours incomplètes, dans le tome IV de la Correspondance Générale de Marcel Proust, parue chez Plon en 1933.
La première lettre de Proust a un liséré de fin de deuil et est envoyée de l’hôtel des Réservoirs à Versailles où il séjournera durant quatre mois, après la mort de sa mère. Simone, qui a quatorze ans, est absente de cette lettre de dix pages où Proust alterne conseils médicaux, plaintes personnelles et analyse de la scène théâtrale.
Marcel Proust décide très tôt, dès 1907, de faire de Simone Arman de Caillavet Mlle de Saint-Loup, comme le montre la note : « Ne pas oublier : Statue de ma jeunesse (Simone) ». (RTP, I, 939).
Cette datation est confirmée par une lettre du 14 avril 1908[12], pour la première fois envoyée du 102 boulevard Haussmann. C’est encore une lettre à liserés noirs de fin de deuil et qui suit la première rencontre de Marcel Proust et de Simone :
…j’aime mieux votre fille et les prodigieux raccourcis d’intelligence d’un regard ou d’une exclamation… Elle m’a fait connaître quelque chose que je ne ressens jamais : la timidité. J’ai compris ce que cela devait être, je crois que c’était la première fois. (Corr. VIII, 92).
Cette rencontre est aussi rappelée par Céleste Albaret :
Un soir où il a voulu savoir à quoi ressemblait la petite Simone… il est allé chez eux ; l’enfant était couchée naturellement ; il devait être au moins minuit :
– Mais Marcel …je ne vais pas la faire se lever et descendre à cette heure-là, a dit Madame de Caillavet
– Madame je vous en prie. J’ai besoin de la voir.
Finalement la petite est descendue, pas contente du tout d’être réveillée.
Il l’a regardée un moment puis :
– Je vous remercie mademoiselle
Et il est parti.[13]
Cet épisode est confirmé par Simone de Caillavet interviewée dans l’émission de Roger Stéphane[14] quand elle déclare : « Je suis Mademoiselle de Saint-Loup, un personnage mineur qui apparaît très brièvement à la fin du Temps retrouvé… Proust a souhaité introduire un personnage de troisième génération qui puisse donner au lecteur l’impression du temps qui s’est écoulé ».
La lettre suivante détenue dans nos collections, toujours à liserés de deuil, se termine comme la plupart des suivantes par « mes hommages admiratifs à mademoiselle Simone » ; une autre, plus touchante et d’un plus petit format est celle où Marcel Proust, abandonnant le papier de deuil fait une déclaration enflammée :
Madame,
On peut aimer des types physiques opposés. Car me voici amoureux de votre fille. Comme elle est méchante d’être aimable car c’est son sourire qui m’a rendu amoureux… Comme votre fille sourit joliment. Comme elle est jolie. Elle me plaît infiniment…
Ce tendre marivaudage n’empêche pas la quête éperdue d’informations. Ainsi ce petit bulletin : « Quel est donc ce mot tellement gentil que votre fille a eu quand vous lui avez dit qu’elle ne vous ressemblait pas. Je ne m’en souviens pas très exactement… »
Au décès de Léontine Arman de Caillavet, en qui certains ont voulu voir Madame Verdurin, Marcel Proust n’envoie pas moins de quatre lettres, dont une à Simone le 13 janvier 1910, les autres étant destinées à Gaston, Jeanne et à Anatole France : « C’est peut-être indiscret à moi qui n’ai l’honneur de vous connaître que si peu, de me permettre de venir à vous dans votre chagrin ». (Corr. X, 26).
Le 28 janvier, il demande avec insistance une photographie à Simone en expliquant que « sa mémoire, fatiguée par les stupéfiants, a de telles défaillances que les photographies [lui] sont très précieuses. Je les garde et ne les regarde pas trop souvent comme renfort pour ne pas épuiser leur vertu ». (Corr. X, 40). Il s’imagine le gentil mari qu’elle pourra épouser un jour puis ajoute qu’il fit des choses prodigieuses pour obtenir une photographie de Jeanne : « Je reçois encore au jour de l’an des cartes de Périgourdins avec qui je ne m’étais lié que pour tâcher d’avoir cette photographie. » Cette histoire sera reprise dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs où il remplacera « périgourdin » par « ennuyeux ». (RTP, I, 503).
Dans une autre lettre, il dit « Je pense beaucoup à votre fille. Quel ennui qu’elle n’aille pas à Cabourg… », puis il termine par une perfidie : « vous ai-je raconté que j’y vois tous les ans un cousin à vous, le jeune P. qui a l’air d’être amoureux de votre fille… ». (Corr. XI, 155). Or le jeune Prémonville n’est pas amoureux de Simone car il n’est autre que Maurice Pouquet qui est l’amant de Jeanne depuis 1906 et qu’elle épousera à la mort de Gaston.
Autre particularité de ces lettres : toutes celles adressées à Jeanne Pouquet avant mariage ont été brûlées et seules demeurent les lettres, rassemblées par Simone, que Proust a adressées d’abord à Madame Arman de Caillavet puis à Madame (Maurice) Pouquet ; celles adressées à Simone seront curieusement retirées du volume et ne nous sont connues que par la version Plon de 1933 et les 21 tomes de l’édition procurée par Kolb.
Le 13 janvier 1915, Gaston meurt. Le jour de son retour à Paris, Jeanne reçoit de Proust la lettre suivante : « Madame je veux vous voir. Je ne pourrais pas vous parler, les larmes m’étoufferont, mais je veux vous voir ». (Corr. XIV, 29). Jean-Yves Tadié qualifiera cette amitié « d’amitié qui frôle le veuvage partagé ». Et en avril 1915 Marcel Proust écrira à Jeanne (idée qu’il reprendra dans la Recherche) : « Je revois vos fiançailles, votre mariage et l’idée que vous soyez veuve, vous qui êtes toujours pour moi la jeune fille d’autrefois, me déchire le cœur ». (Corr. XIV, 97). Et il poursuit : « J’ai tellement pensé à sa fille, dont il était si fier [formule qu’il reprendra dans le Temps retrouvé à votre chère mademoiselle Simone que je ne vois plus du tout ».
Les lettres que Proust envoie d’abord à Jeanne avec une conclusion sous forme de « Je pense tendrement à vous, à votre fille, à Gaston », puis à Simone, sont empreintes de cette empathie de Proust face au deuil. Proust se pique de diriger les lectures de Simone ; ainsi rêve-t-il de lui faire lire George Eliot et en particulier Le Moulin sur la Floss. Ce roman, qui se termine par deux noyades, lui permet de parler de son quartier qui subit à ce moment-là la grande inondation de février 1910. Il va, comme le rappelle Jean-Yves Tadié[15], jusqu’à étudier l’écriture de la jeune fille qu’il va prêter à Gilberte et cette connaissance de l’écriture de Gilberte permettra au Narrateur de réaliser sa confusion entre l’écriture de Gilberte et celle d’Albertine.
Proust, apprenant que Simone est devenue journaliste, demandera à Paul Morand en mai 1917 : « Comme vous serez gentil de m’envoyer l’article de Mlle de Caillavet sur les Ballets russes. Je ne la connaissais pas comme critique. » À noter que l’article, paru dans le Gaulois, est un assassinat en règle de « Parade ».[16]
En 1922, Proust continue à écrire à Jeanne : « Mon affection pour Gaston eut vers cette époque un effet de vaccin que je n’avais pas cherché. Elle m’immunisa contre les souffrances trop vives dans l’amour que m’inspira mademoiselle Pouquet. » (Corr. XXI, 138).
C’est Céleste qui raconte leur dernière rencontre à une soirée Hennessy[17] (Jeanne pense qu’il s’agit d’une soirée chez la comtesse de Mun, rue de la Faisanderie) :
Jeanne est désireuse de partir.
– Madame… Puis-je vous raccompagner ?
– Pas ce soir, je vous prie. Nous nous verrons un autre jour si vous le voulez bien.
– Soit Madame. Mais alors je vous dis adieu, nous ne nous reverrons jamais…
Proust devait continuer à suivre Simone puisqu’il écrit à Guiche en septembre 1922 :
J’ai ouvert le Figaro et comme il était mal paginé je suis tombé sur les nouvelles mondaines. Là, j’ai vu qu’à Deauville la fille d’une amie à moi, la deuxième grande passion de mon adolescence, laquelle fille a épousé le plus détestable des Roumains, avait donné un thé en l’honneur du shah de Perse et un goûter en l’honneur du Prince de Grèce. (Corr. XXI, 261).
Jeanne écrira sur ce sujet à sa fille lorsque les lettres à Armand de Gramont, duc de Guiche, seront publiées : « Je me souviens que Stoicesco lui faisait horreur. Il me l’avait dit en termes violents. Ils avaient dû se disputer dans quelque rue de Sodome[18] ».
De fait, Marcel Proust ne devait jamais revoir ni Jeanne ni Simone, et celles-ci ne devaient même pas être présentes à son enterrement. Simone avait la grippe et Jeanne n’était pas à Paris. Ainsi, comme le note Michèle Maurois : « Ni celle dont Gilberte devait garder pour des siècles une part, ni Mademoiselle de Saint-Loup n’accompagnèrent leur ami à sa dernière demeure. » C’est deux ans après la mort de Marcel Proust que Simone, par l’entremise de Grasset, allait faire la connaissance d’André Maurois et l’épouser le 6 septembre 1926.
Jacques Letertre
L’article est publié ici : https://www.amisdeproust.fr/en/component/k2/item/222-parution-du-bulletin-marcel-proust-n-71-2021
[1] Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, éds. Pierre Clarac et André Ferré, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1954, Préface, p. xvi.
[2] Correspondance de Marcel Proust, éd. Philip Kolb, Paris, Plon, vol. XVIII, p. 359. Lettre à Jean de Gaigneron, 1er août 1919.
[3] Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, éd. Jean-d. Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1989, p. 609.
[4] Placard n°31 du dernier manuscrit d’octobre 1917 des Jeunes Filles en fleurs inséré dans l’édition de luxe des Jeunes filles de 1920 en cinquante exemplaires (n° XVIII) sur papier bible.
[5] Jacques Dubois, Le Roman de Gilberte Swann, Paris, Le Seuil, 2018 p. 216.
[6] Photo originale tirage argentique 1922. Portrait de Simone de Caillavet-Stoicesco (270mm/145mm).
[7] Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, Gallimard, 1996, p. 132.
[8] Exemplaire original de 1874 de la seule pièce que Flaubert fit représenter (échec total après seulement quatre représentations). Trois lettres manuscrites de Flaubert sont jointes, toutes trois adressées à son ami Édouard Laporte en 1873-1874. Laporte est le type même de l’homme politique courageux et honnête, à la différence du héros du Candidat.
[9] Édition originale en tirage de tête (un des 10 Hollande) de Miss Howard : la femme qui fit un empereur, dont le dédicataire est André Maurois. Paris, Gallimard 1956.
[10] Marcel Proust, op. cit., p. 132.
[11] Michelle Maurois dans son livre en trois tomes chez Flammarion sur la famille Caillavet (L’Encre dans le sang 1982, Les Cendres brûlantes 1986 et Déchirez cette lettre 1990) jette un regard sans complaisance sur cet étrange « tribu » et en particulier sa marâtre Simone André Maurois.
[12] Correspondance autographe signée de Marcel Proust, dont 19 lettres envoyées à Jeanne Arman de Caillavet, une à Marie Scheikevitch et deux cartes pneumatiques destinées à Gaston Arman de Caillavet. Cet ensemble offert en 1948 par Jeanne à sa fille a été relié pour celle-ci par V. Grandchaud en plein maroquin incarnat et est revêtu de l’ex-libris de Simone André Maurois.
[13] Céleste Albaret, Monsieur Proust, Paris, Robert Laffont, 1973, p. 223
[14] Roger Stéphane, Marcel Proust : Portrait Souvenir, 1962.
[15] Marcel Proust, op. cit., p. 645
[16] Paul Morand, Le Visiteur du soir, Genève, La Palatine, 1949.
[17] Monsieur Proust, op. cit., p.405
[18] Michelle Maurois, Déchirez cette lettre, Paris, Flammarion, 1990, p. 331.